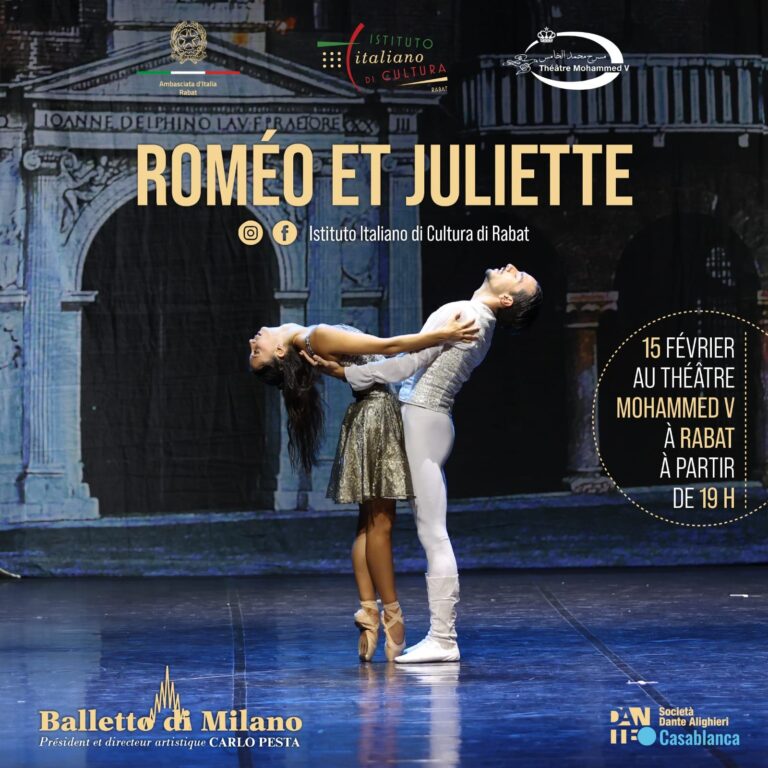L’aube des relations italo-marocaines
(Le temps du dialogue : deux siècles de relations entre l’Italie et le Maroc)
Prendre la parole à Fès, au cœur de la mémoire du Maroc et de la pensée méditerranéenne, c’est revenir à l’aube des relations entre l’Italie et le Maroc — et reconnaître, dans cette rencontre, la continuité d’un dialogue qui traverse les siècles.
Fès est une cité qui garde dans la pierre et dans la parole la sagesse du temps.
Ses murs, ses écoles et son université portent un héritage qui n’appartient pas seulement au Maroc, mais à toute la Méditerranée.
C’est pour moi un grand honneur d’être ici, dans une ville qui incarne mieux que toute autre la mémoire vivante et l’âme spirituelle du Royaume.
Toute relation entre États, comme entre personnes, naît d’un geste de reconnaissance. Le temps la transforme, mais son essence demeure.
Ainsi en est-il du lien entre l’Italie et le Maroc : si nous célébrons aujourd’hui deux siècles de relations diplomatiques, c’est parce que leurs racines plongent dans une histoire bien plus ancienne, faite de voyages, de rencontres et d’échanges qui précèdent la diplomatie moderne.
Bien avant 1825, nos deux rives avaient déjà appris à se connaître.
Au Moyen Âge, les navigateurs et les marchands italiens sillonnaient ces eaux, atteignant les ports de Safi, de Salé, d’Anfa et de Mogador.
De Gênes et de Venise, de Pise, Naples et Livourne, partaient des navires chargés non seulement de marchandises, mais aussi de mots, d’idées et de curiosité.
De Florence, cœur de l’humanisme, arrivaient des savants, des cartographes et des artisans attirés par les sciences et les arts du monde arabe.
Et de Palerme, carrefour de civilisations, embarquaient des navigateurs et des religieux qui connaissaient les langues et les routes de la Méditerranée.
Mais de ces ports marocains aussi partaient des voyageurs, des lettrés et des commerçants porteurs d’un savoir raffiné, d’une foi confiante et d’une vision du monde ouverte sur la Méditerranée.
Ainsi, entre les deux rives, s’établissait déjà un échange de connaissances et de valeurs, bien avant la diplomatie moderne.
Ces échanges n’étaient pas seulement commerciaux : ils étaient des rencontres entre des femmes et des hommes unis par une même mer et une même vocation au dialogue.
Les chroniqueurs de l’époque évoquent des lettres et des ambassades, des échanges de présents, des accords maritimes et des négociations pour la sécurité des routes — signes d’une familiarité qui, depuis des siècles, précède la diplomatie moderne.
Sur ces routes se formèrent des hommes capables de comprendre les deux rives : artisans, interprètes, érudits, religieux.
Les cités maritimes italiennes et les ports marocains furent les premiers laboratoires d’une Méditerranée partagée, où la langue du commerce se mêlait à celle de la culture et du respect mutuel.
C’était une diplomatie sans protocole, mais avec un langage universel : celui de la curiosité et de la confiance.
De cette longue habitude naquit, deux siècles plus tard, la volonté de donner une forme durable à une amitié déjà existante.
Une amitié que le Traité d’amitié et de commerce de 1825, conclu entre le Royaume de Sardaigne et le Sultanat du Maroc, vint consacrer dans le respect mutuel et dans la reconnaissance de la souveraineté de chacun.
C’était une époque où la Méditerranée était traversée par des tensions, mais aussi par des diplomaties clairvoyantes, qui voyaient dans la mer non pas une frontière, mais un pont.
Ce traité ne naquit pas d’intérêts de puissance, mais d’un choix de confiance.
Deux États, conscients de leurs différences, décidèrent de se reconnaître et de dialoguer.
L’Italie, qui n’était pas encore unie, cherchait dans ce rapport un canal de connaissance vers le monde arabe et africain ; le Maroc, pour sa part, exerçait sa souveraineté en dialoguant d’égal à égal avec les puissances du temps, fidèle à sa tradition d’indépendance et d’ouverture.
Dans cet accord, sobre mais visionnaire, furent jetées les bases d’une amitié fondée non sur la force, mais sur le respect et la confiance.
Cet engagement avait une valeur politique, mais aussi symbolique : deux nations se tendant la main au nom de la coopération, anticipant une vision moderne de la Méditerranée comme espace d’équilibre et d’échanges.
C’était le commencement d’un temps nouveau : l’aube d’une relation appelée à durer deux siècles et à grandir au rythme du monde.
Cinquante ans plus tard, en 1875, la mission conduite par Luigi Scovasso arriva à Fès.
Ce fut un moment de haute importance diplomatique : la première ambassade du jeune Royaume d’Italie auprès d’un pays arabe et musulman.
Le peintre Stefano Ussi en immortalisa la scène dans un célèbre tableau représentant la rencontre de deux mondes qui ne se craignent pas, mais se reconnaissent.
Parmi les membres de la mission figurait Edmondo De Amicis, qui, dans son Maroc, sut raconter cette expérience non comme une curiosité exotique, mais comme un dialogue entre civilisations fondé sur le respect et la connaissance réciproque.
La mission italienne parcourut le pays avec curiosité et respect.
Ses membres décrivirent la beauté des paysages, l’élégance des villes et la sagesse des traditions.
Fès apparaissait comme un entrelacs de voix et de couleurs, un carrefour de savoirs où la diplomatie trouvait un sens dépassant la politique : celui de la rencontre des cultures.
De cette expérience naquit une leçon appelée à durer : la véritable diplomatie ne se mesure pas aux protocoles, mais à la capacité d’écouter, de comprendre et de partager.
Fès, capitale du savoir et de la spiritualité, accueillait une Italie qui cherchait à se définir comme une nation ouverte sur le monde méditerranéen.
De cette rencontre naquit une grammaire diplomatique qui inspire encore aujourd’hui nos relations : l’écoute comme forme de connaissance, la coopération comme instrument de paix, la culture comme langage universel.
Et Fès, avec sa tradition de savoir, nous rappelle que la connaissance est la première forme de coopération entre les peuples — le point de départ de toute véritable diplomatie.
Les relations entre l’Italie et le Maroc ont traversé tout le XXᵉ siècle en conservant une remarquable cohérence d’esprit.
Même lorsque le monde changeait rapidement, le lien humain et culturel entre nos deux pays demeurait intact.
Des générations d’Italiens et de Marocains se sont rencontrées dans les écoles, sur les chantiers, dans les universités, dans les ateliers d’art et dans les entreprises.
Ce furent des enseignants, des architectes, des médecins, des étudiants, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui, avec discrétion et constance, ont contribué à bâtir un dialogue quotidien fait de gestes plus que de mots.
C’est grâce à ce tissu vivant de relations que l’amitié entre nos deux nations n’a jamais perdu de sa vitalité.
Les relations internationales, lorsqu’elles s’enracinent dans la société, deviennent un patrimoine commun : elles n’appartiennent plus aux gouvernements, mais aux peuples qui les incarnent.
Aujourd’hui, deux siècles plus tard, la Méditerranée nous invite à imaginer un nouveau modèle de coopération.
L’Italie et le Maroc partagent la même conviction : l’avenir n’appartient pas aux économies isolées, mais aux sociétés capables de collaborer.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le Plan Mattei pour l’Afrique,
à travers lequel l’Italie promeut une vision de co-développement fondée sur trois principes tournés vers l’avenir : l’égalité de dignité, la formation et le développement partagé.
Ce plan s’inscrit dans une vision partagée avec nos partenaires africains et méditerranéens, convaincus que le développement ne se construit qu’ensemble, dans le respect mutuel et la confiance réciproque.
Le Plan Mattei n’est pas une initiative, mais une méthode : construire ensemble, dans le respect des priorités et des aspirations de chaque pays partenaire.
C’est une proposition à la fois politique et morale : partager la valeur de la connaissance, non exporter des modèles ; unir les rives de la Méditerranée dans une logique de partenariat et non de dépendance.
La Méditerranée, aujourd’hui, n’est pas seulement une frontière géographique : c’est un laboratoire de l’avenir.
Pour l’Italie, située au centre de cette mer, la Méditerranée n’est pas seulement une dimension, mais une mission : unir ses deux rives en conjuguant passé et futur, dialogue et développement. C’est notre identité et, en même temps, notre responsabilité.
C’est ici que se croisent les routes de l’énergie, de la technologie, des migrations et des cultures.
Et c’est ici que se décidera si le monde saura construire un nouvel équilibre fondé sur la coopération.
Dans le sillage de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a su conjuguer identité et progrès, préserver son héritage tout en le projetant vers l’avenir.
C’est une vision qui unit les racines africaines, l’ouverture méditerranéenne et la vocation atlantique du Royaume, et qui trouve en l’Italie un partenaire attentif et solidaire.
C’est dans cette synthèse entre tradition et modernité que nos deux pays trouvent aujourd’hui la clé d’une collaboration authentiquement méditerranéenne.
Aujourd’hui, nos deux pays avancent ensemble, convaincus que leur dialogue peut inspirer une Méditerranée plus équilibrée et plus solidaire.
La Méditerranée n’est pas seulement un lieu : c’est un système de valeurs, une dimension éthique.
Depuis des siècles, elle est le carrefour des idées, des religions et des échanges, mais aussi des découvertes et des renaissances.
Aujourd’hui, sa stabilité et sa prospérité dépendent de la capacité des nations qui la bordent à en faire un espace de coresponsabilité et de confiance réciproque.
L’Italie et le Maroc, par leur histoire et leur position, peuvent être les piliers de cet équilibre euro-méditerranéen, en unissant leurs énergies et leurs cultures pour promouvoir la stabilité et le développement partagé.
Il ne s’agit pas de revenir à un passé idéalisé, mais de construire un avenir réaliste, fondé sur la confiance et la coopération.
Et cet avenir aura surtout besoin de la jeunesse : d’étudiants polyglottes, d’entrepreneurs ouverts sur le monde, de chercheurs et d’artistes capables de transformer la connaissance en dialogue.
Car les relations entre nos pays ne se mesurent pas seulement aux chiffres économiques, mais au désir d’apprendre les uns des autres, de découvrir dans la différence une part de soi-même.
À une époque de transitions — énergétique, numérique, démographique —, le véritable défi est de faire en sorte que la croissance soit également juste et que le progrès technologique n’abandonne personne.
La culture et la formation seront le langage commun de la Méditerranée de demain.
Après des siècles d’histoire partagée, l’Italie et le Maroc démontrent que la coopération entre les deux rives peut être un chemin concret de prospérité et de dignité.
Fès, berceau de la connaissance et de la foi, nous rappelle que le dialogue n’est jamais un signe de faiblesse, mais de force : la force de la connaissance, de la mémoire et de la confiance.
Car le temps du dialogue n’appartient pas au passé, mais à l’avenir : c’est le temps où la diplomatie devient culture et la culture politique de la paix.
Et c’est peut-être là la plus belle mission que notre époque confie à la Méditerranée : continuer à se parler, à se connaître, à se reconnaître.
Car dans le dialogue réside la mesure la plus haute de la civilisation humaine : la capacité d’écouter sans crainte et de construire sans préjugés.